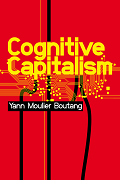Plan
Une crise trainante
Deux ans après l’effondrement foudroyant des crédits immobiliers subprimes et de tous les produits financiers qui les intégraient dans leur montage opaque, la grande crise financière rode encore. Certes, les grands établissements financiers ont été sauvés, les banques centrales de toutes les économies importantes ont injecté plus de liquidités en un an que de 1929 à 1939, la bourse s’est redressée, l’activité économique aussi en attendant de replonger comme la seconde boucle d’un W avachi et non pas d’un v, petite césure sans importance qui permet




de revenir aux affaires financières et à de nouvelles bulles. Certes, le monde s’est arrêté au bord du gouffre d’une seconde « Grande Dépression ». Et mesurons bien le gouffre : le 20 septembre 2008, quelques jours après la faillite de Lehman Brothers, juste avant le premier plan H. Paulson, Bern Bernanke, le gouverneur du FED a eu ces mots : « Faute d’action immédiate, il n’y aura plus d’économie mondiale dans moins de cinq jours »1. La reprise s’est accompagnée de la réémergence de bulles (en particulier immobilière en Chine et ailleurs). L’énorme richesse mondiale permet de supporter des surproductions aussi hallucinantes que celle qu’on observe dans l’Empire du Milieu où les surcapacités de ciment produit excèdent la totalité de la consommation américaine, indienne et japonaise2. Mais, le spectre d’une rechute majeure rode toujours sous la forme d’une crise fiscale des Etats (toujours annonciatrice des bouleversements politiques révolutionnaires comme lors de la chute des monarchies anglaise et française) et d’une crise du système monétaire international avec la remise en cause du privilège exclusif de seigneuriage3 de la monnaie de réserve internationale qui a déjà commencé4. Un rétablissement durable dépend désormais d’un nouveau New Deal bien plus complexe et ardu que celui des années1930 même si le tissu international et surtout transnational ou cosmopolitique paraît plus solide qu’alors, moins susceptible de se déchirer d’un coup dans un affrontement mondial. Paul Krugman5 parle désormais de Grande Récession, pour démarquer la situation actuelle de celle de la Grande Dépression du siècle dernier (ou de la longue stagnation de l’économie mondiale dans la décennie 1887-1899). On peut aussi évoquer une stagnation rampante et interminable comme les dix ans qui ont suivi l’éclatement de la bulle immobilière et bancaire japonaise dans les années 1990.
La douche écossaise de Copenhague.
L’autre invitée de la fête, la question écologique n’est pas du tout réglée. De la coupe des résolutions aux lèvres des mesures contraignantes, il y a encore loin. Beaucoup s’étaient réjouis d’une rapide prise de conscience des chefs d’Etat de la planète qui ont tous juré leurs grands dieux que la lutte contre le réchauffement climatique, en particulier pour les Etats du Sud (les 150 millions de citoyens du Bengladesh étaient les premiers concernés par leur nombre), naguère raillé comme une lubie était devenue une priorité fondamental. Le sommet de Copenhague vient de doucher les enthousiasmes prématurés. Certes, les pays du Sud sont fondés à refuser un ordre contraignant sans contrepartie de développement économique. Il faut comprendre leur scepticisme, compte tenu des expériences passées. Une croissance faiblement carbonée (ne recourant ni au charbon, ni au pétrole) comme la Suède vient de se le fixer à un horizon très proche 2012, apparaît déjà comme extrêmement difficile à des pays très développés. Que dire pour des pays émergeants ? D’autre part, les Etats-Unis d’Obama ont pu mettre en avant la priorité d’une loi dotant de la protection sociale 36 millions d’habitants. L’histoire est lente. Mais, derrière ces obstacles de circonstance, il se pourrait que la planète butte sur des réalités géostratégiques plus tenaces.
Le cadre de l’ONU, cadre international, qui comme le nom l’indique continue de reposer sur la légitimité en dernière instance de la souveraineté des Etats, est apparu dans toute sa faiblesse. Un veto chinois, indien et américain et c’est plus de 50 % du problème et donc de sa solution qui passe à la trappe. Les Etats Européens et le Japon qui appartiennent déjà à l’ordre post Westphalien6 et post national puisqu’ils ont accepté d’abandonner certains pans de leur souveraineté dans la construction Européenne, et pour certains (l‘Allemagne et le Japon) se sont interdit le droit de déclarer une guerre offensive. Dans le cas européen, des renonciations plus symboliques encore ont été effectuées avec l’interdiction de la peine de mort et la soumission à l’autorité effective du Tribunal Pénal International. Le protocole de Kyôto en matière écologique constitue une limitation de plus de la souveraineté étatique. Les pays qui ont résisté fortement à Copenhague, en automne 2009, à l’adoption d’un protocole contraignant en matière de rejet de CO2 sont les mêmes qui résistent le plus à une limitation supranationale dans le domaine de la justice interne. Le droit de la terre, des plantes, des espèces menacées est en train de susciter un droit d’ingérence tout comme l’émergence des droits de l’Homme a affaibli le caractère illimité et indivisible de la souveraineté des Etats Nations. On constate donc sur le front de l’urgence écologique, une véritable impasse au niveau international. Les petits et grands nationalismes, pour des motifs parfois opposés (comme c’est le cas entre l’Inde, la Chine et les Etats-Unis), n‘ont pas encore accédé à la maturité post nationale. Les premiers entendent rattraper une puissance humiliée de longs siècles par l’Occident. Les seconds, comme puissance impériale qui a dépassé le vieux colonialisme européen, sont ouvert à un dépassement du national chez ….les autres, mais pas chez eux.
L’hypothèse de la bifurcation du capitalisme
Quoiqu’il advienne du droit d’ingérence écologique, nécessaire à la réalisation d’un effort significatif en matière de réchauffement climatique, l’urgence d’agir n’en sera pas diminuée pour autant. Au contraire. Et c’est là qu’apparaît un élément étrange qui redéfinit le sens d’une alternative par rapport aux deux grandes dépressions précédentes : celle de la fin du XIX° siècle, la Longue Dépression (1873-1896)7 et celle des années 1930, la Grande Dépression. La première, suite de crises financières, monétaires et de ralentissements économiques voit naître le Mouvement ouvrier et l’espoir d’une alternative au capitalisme libéral. La seconde dans un monde divisé par la révolution de 1917 et ses conséquences, marque l’absorption du mouvement ouvrier à l’Ouest (New Deal, Front Populaire) mais en même temps la limite du socialisme qui ne s’y impose pas comme alternative. La troisième crise qui débute avec la fin des Trente Glorieuses par le choc pétrolier, l’abandon de l’étalon de change or, se poursuit par la contre-révolution néolibérale thatchérienne et reaganienne, et marque la chute du socialisme réel (1989) puis la crise du socialisme malgré les efforts du blairisme. Or cette période est aussi celle de la maturation du mouvement écologique qui apparaît comme la seule alternative là où le communisme d’Etat chinois tout comme la social-démocratie ont du mal à se différencier quant à leur recette pratiques de l’économie sociale de marché de l’ordo libéralisme de Walter Eucken, Wilhelm Röpke et Alfred Müller-Armack.
Ce qui apparaît soudain comme possible, avec le dernier avatar de la crise financière et sa non résolution sur le fond, ce n’est rien moins qu’une fourche, une bifurcation majeure du capitalisme. Tout ce qui semblait évident, éternel hier, est devenu discutable. Sans doute, le fait que soit en question désormais notre avenir lui-même dans l’étroite biosphère qui conditionne l’air, l’eau, la chaleur, la vie tout court sous toutes ses formes terrestres, n’est pas pour rien dans cette brutale mise à plat de la science économique, de la crédibilité de la forme d’organisation dominante de l’activité humaine (le marché, le salariat, la production).
Mais alors, ceux qui viennent de finir les huit premiers chapitres de ce livre se poseront forcément une question. Le capitalisme cognitif dont sont décrits les premiers traits et l’émergence systémique depuis 1975 n’est-il pas mort né dans cette crise qui pourrait bien balayer jusqu’au capitalisme tout court ? Ne risque-t-il pas d’avoir duré une trentaine d’années en tout et pour tout (1975-2007) ? Si la situation se tend, les marges de manœuvre que cette déclinaison cognitive du capitalisme semblait offrir au capitalisme tout court, fondent les unes après les autres. Certaines prises de position violement hostiles aux échanges de contenu peer to peer considérés comme « intolérables » se sont exprimées sans retenue désormais : le gratuit c’est du vol selon Denis Olivennes autour d’un Rapport à l’origine du dispositif répressif contre le téléchargement (loi Hadopi) en France. Le durcissement des classes possédantes dans la tourmente est plutôt la règle. S’il venait s’y ajouter la peur de perdre une partie de leurs avantages, leur réaction ne serait pas différente des hurlements d’orfraie que nous avons entendus aux Etats-Unis à propos du « communisme rampant » de l’administration Obama. Ce dernier au reste n’a-t-il pas été accusé de n’être pas un véritable américain ?
La crise financière semble plutôt favoriser le « retour aux fondamentaux » tout à fait comparable à ce qui suivit la crise dot-com en 2001. L’économie de l’immatériel ne se trouvera-t-elle pas la première sur la sellette ? Et la voie du « réformisme capitaliste » que représente le capitalisme cognitif bloquée par la crise ?
La réponse à ces questions compliquées dépend largement du diagnostic que l’on porte sur la crise actuelle, sur sa nature. Si c’est le capitalisme qui a changé de base, il se pourrait bien que ce que la crise annonce, les remèdes qu’elle appelle, la transformation qu’elle est en train d’accoucher démentent à la fois ceux qui croient tenir enfin le grand écroulement, prélude nécessaire au Grand Soir (le camp de la révolution), ceux qui ne voient là qu’une péripétie formelle, une crise de croissance (les partisans du progrès ou les cyniques du retour au business as usual), mais aussi ceux qui prônent un retour à une économie plus régulée et moins spéculative (les raisonnables). Bref, comme l’histoire a coutume de le faire, tout le monde aurait tout faux. Personne ne pourrait se prévaloir d’avoir imaginé le chemin que prendrait le cours du monde. On ne tranchera pas ici si l’histoire est une suite de moments intemporels (pattern of timeless moments)8, on se contentera de dire qu’elle ressemble à des bifurcations brusques sur lesquelles il est impossible de calculer des dérivées de trajectoire. Commençons donc par examiner le diagnostic le plus général et le plus simple que l’on puisse faire de ce qui s’est passé entre 2007 et 2009.
Un irrépressible emballement du crédit
La crise financière se résume à un fait très simple : les liquidités, c’est-à-dire le montant des encours de crédit (donc de créances et de dettes des divers agents), a été multipliée de façon spectaculaire par rapport à ce qu’il était encore dans les années 1970. L’inflation des prix des biens ou des coûts dont les salaires des années 1960-1980 a été remplacée par une inflation des actifs financiers.
Cette multiplication des moyens de paiement liquides à partir du crédit (la véritable source de création ex nihilo de monnaie) s’est observée à toutes les étapes de la monnaie et a revêtu différentes formes très techniques. L’essentiel est de comprendre que les transformations des règles encadrant la création monétaire dans les différents agrégats vont dans toutes dans cette direction.
Ainsi le pourcentage des fonds propres (donc des moyens de mobiliser immédiatement des ressources en liquide qui était de 8% du montant de leur engagement et que l’on nommait le ratio de Cook a été modifié. On parle dorénavant du ratio Mac Donough. Quelle est l’innovation que ce dernier ratio a introduite ? Pour déterminer le maximum de crédit que peut accorder la banque par rapport à ses fonds propres (c’est-à-dire les capitaux qu’elle est capable de mobiliser très vite pour faire face à des exigences de remboursement) on a ajouté le risque opérationnel « les risques de pertes liés à des personnes ou à des systèmes défaillants » ce qui semble la responsabiliser mais aussi le « risque de marché » de sorte que la valeur du crédit accordé par la banque doit être ajustée à sa valeur de marché9. S’il est coté et que le marché est à la hausse, l’actif de la banque augmente et elle peut accorder davantage de crédit. Si c’est l’inverse elle devra augmenter ses liquidités de garantie en vendant des titres. Cette mesure est pro cyclique : au lieu de contrecarrer et d’équilibrer les mouvements conjoncturels, elle les accentue ; elle est un accélérateur « d’exubérance des marchés » (pour parler comme Alan Greenspan) en période faste mais aussi un accélérateur de dépression en cas de baisse.
La « dérégulation » a été marquée par des innovations financières comme la titrisation de la dette publique, puis des crédits immobiliers (collateral debt obligations), comme les accords d’assurance sur défaut de paiement (swap), comme les produits dérivés ou les LBO10. Il est inutile de se demander qui a commencé entre ces innovations financières et les modifications du cadre juridique comptable, car en fait, comme la poule et l’œuf, elles se sont rapidement répondues et se sont épaulées les unes les autres.
Ce qui fondamental en revanche, c’est le résultat de ces techniques. La leviérisation ou capacité d’augmenter le montant des prêts consentis à partir de dépôts préalables et plus globalement des fonds propres des institutions financières a été multipliée par 5 à peu près. Là où un euro de ressources immédiatement convertibles en liquide permettait autrefois d’accorder entre 5 à 8 euros de crédit donc de liquidités nouvelles (ratio de Cook), on est arrivé à la veille de la crise à 30 à 35 euros11. Cette innovation correspond au mouvement profond de dématérialisation de la monnaie : les liquidités nécessaires au fonctionnement de l’activité humaine ont dépendu de moins en moins d’un stock préalable de monnaie métallique. L’invention de la monnaie fiduciaire (les billets de banque et les lettres de change qui sont des reconnaissances de dettes à terme qui circulent comme instrument de paiement) comme les droits de tirage spéciaux, la suspension de la convertibilité or des monnaies partagent toutes cette caractéristique. On remarquera au passage que cette dématérialisation extrême de la monnaie traduit le fait que la confiance envers le futur s’accroît avec l’accumulation du capital et du sentiment d’interdépendance croissante qui règne au sein d’une société complexe. Le risque de défaillance absolue (banqueroute systémique) y est beaucoup moins fort que dans une société faite d’addition d’éléments disparates et d’interactions non maîtrisées. Comme la monnaie est le lien avec le futur (définition admirable de Keynes), l’augmentation de la masse monétaire (qui réunit les actifs totalement liquides, les actifs facilement liquidables et les diverses formes de placements à long terme) obéit à la densité et l’intensité des échanges entres les agents économiques. L’accord sur le montant de crédit qu’une société accorde à ses différents agents économiques, des ménages à l’Etat en passant par l’entreprise constitue un pari sur le futur qui doit être validé ex post. Voilà pourquoi, il n’a pas de limites intrinsèques. Il dépend de la richesse anticipée par les agents et de leur accord sur la nature de la richesse des nations. Il faut donc relativiser le caractère étonnant de la création de monnaie à travers l’attribution de crédit. S’il n’en allait pas ainsi, la monnaie ne serait que la répartition différente d’une même masse monétaire. Or celle-ci n’a cessé d’augmenter au cours de l’histoire.
Cela écrit, l’endettement favorisé par le « commerce des promesses » (P.-N. Giraud) donne le vertige. Au numérateur, les milliers de milliards de dollars sont déjà impressionnants. Ce qui a introduit une panique dans les marchés engagés dans la course au multiplicateur de possibilités et au diviseur de risques, c’est un doute soudain sur le dénominateur, autrement dit sur la nature et la mesure de la contrepartie. Les crises financières reflètent toujours une crise de confiance, jamais une question technique. Elles suspendent le lien avec le futur qu’est la monnaie crédit : le crédit consenti à ce qui n’est pas encore mais qui est capable d’ores et déjà d’agir sur le présent. Voilà sans doute pourquoi les crises de confiance sont si brutales mais si spectaculaires aussi, les rétablissements.
La question de l’immoralisme de la finance de marché, des mécanismes qui favorisent l’endettement à outrance et l’irresponsabilité d’une prise de risque qui n’engrange que les gains et se défausse des pertes, est certes importante. Elle a été posée ex ante par Frédéric Lordon12 ou par Michel Aglietta13 qui ont demandé inlassablement qu’un contrôle démocratique et social soit effectué sur les principaux acteurs de la finance (en particulier sur les fonds de pensions) et que l’on remette en cause le retour du pouvoir de l’actionnaire (shareholders) au détriment des salariés et managers (stakeholders), ce que l’on appelle le régime de la « valeur actuarielle ». Toutefois, dans l’état actuel de la dette privée et du doublement de la dette publique, les dispositions réglementaires plus sévères se heurtent à un obstacle de taille. Si elles retournent vraiment à un ratio des encours gagés sur les dépôts préalables (à un multiplicateur de 5 par exemple), elles auraient un tel effet d’assèchement du crédit que le prix politique à payer en termes de dépression générale de l’économie conduirait à des situations de chaos révolutionnaires.
Quelle est la contrepartie de l’argent avancé par le banquier pour un projet quelconque à un agent économique (ménage, étudiant, entreprises, collectivité locale, banques, Etat) et validé par la banque centrale ? C’est la confiance que le projet est viable, que l’argent sera remboursé. Cette confiance se fonde sur des fondamentaux matériels (patrimoniaux par exemple) mais aussi sur des appréciations des espérances de profit ou de la viabilité supposée de ces projets, leur potentiel de valeur, qui aujourd’hui inclut leur utilité sociale, le renom qu’ils procurent, les électeurs qu’ils fidélisent, les clients ou fournisseurs qu’ils stabilisent, les troubles politiques qu’ils évitent etc.
Bref le crédit et la création de monnaie qui lui est liée procèdent de la confiance dans le futur. Une économie qui ne prête pas est une économie qui ne se voit aucun futur ou un futur très trouble et qui donc se condamne à ne pas investir. Deuxième élément, les crédits accordés ne sont pas du tout fictifs au sens d’irréel. Ils ont un effet réel immédiat, car dès qu’un fondateur de start up se voit accorder un crédit par une banque, cet argent existe bel et bien ; il peut acheter des biens, des services, créer des emplois.
Les capitaux créés par la finance de marché sont donc virtuels au sens où le virtuel n’est ni le réel (ce qui est tangible), ni le possible (ce qui n’est pas encore), mais ce qui, du fait d’une représentation concordante du futur devient présent et actif dans le présent en le modifiant. Le virtuel est efficace dans la formation d’une opinion commune sur des valeurs futures.
Le problème n’est donc pas le niveau de l’endettement dans l’absolu mais de sa contrepartie. Cette dernière peut être la confiance politique. Si Barak Obama a pu annoncer le quadruplement du déficit budgétaire américain, c’est parce qu’il a suscité la confiance d’une majorité d’Américains que leur pays peut s’en sortir, et qu’il les a persuadés du contenu d’un triple New Deal (un système de protection sociale universel, un Green Deal avec la planification d’une industrie verte, et un effort éducatif pour redonner aux Etats-Unis leur leadership universitaire). Nous en arrivons à la fausse bonne idée qui s’emboîte admirablement entre une conception de la finance simulacre et celle d’un retour nécessaire à l’économie vraie, réelle, productive face aux capitaux « fictifs ».
Retour à l’économie réelle et matérielle, Ou « C’est la faute au capitalisme cognitif ou immatériel »
Dans le Monde du 21-22 février 2009, S. Sassen a prôné une économie affranchie de la finance sous le titre : Vive l’économie réelle ! Elle y rappelait les échelles de l’endettement tant privé que public.
« Les Etats-Unis (…) affichent aujourd’hui un niveau d’endettement supérieur à ce qu’il était pendant la crise des années 1930. La dette américaine s’élevait à 150 % du produit intérieur brut (PIB) en 1929, et à 260 % en 1932. En septembre 2008, l’encours sur les swaps sur défaillance de crédit (un produit typiquement made in America) s’élevait à 62 000 milliards de dollars, soit plus que les PIB cumulés de tous les pays du monde, qui s’élèvent à 54 000 milliards de dollars. Comme si cela ne suffisait pas, l’encours des produits dérivés dépassait les 600 000 milliards de dollars, soit 14 fois le PIB de la planète. Voilà qui suffit à plonger dans la panique toute personne sensée. »
Après avoir questionné l’utilité de la finance de marché et son caractère délétère, elle proposait une relance de l’économie réelle en particulier en soutenant les industries de main-d’œuvre.
Mais la réponse satisfaisante consiste-t-elle à faire une apologie de l’économie réelle en stigmatisant la financiarisation de l’économie ? Quel est ce réel, ce référent ? Une redoutable ambiguïté affecte les discours de « retour au réel ». Laissons ici leur caractère périlleux sur le plan politique. Si par réel on entend l’économie qui déborde ce que les systèmes actuels de comptabilité publique et d’entreprises enregistrent, oui, on peut soutenir ce retour nécessaire à l’économie réelle. Mais alors, le diagnostic d’excès de liquidité et de crédit ne tient plus.
Plus cohérente avec ce diagnostic, et faisant corps avec les deux idées précédentes que nous avons critiquées, la conception de l’économie réelle à laquelle il est fait référence est celle de l’économie matérielle, industrielle, par opposition à l’économie de l’immatériel, du virtuel, de l’Internet, accusée de faire le lit de la financiarisation. Cette tendance implicite de la revanche des fondamentaux avait déjà été perceptible lors de la crise dot.com de 2001. Comme si le référent de l’activité économique ne pouvait passer que par l’industriel pur et dur, par le patrimonial matériel ou enfin par le patrimonial immatériel (ce qu’A. Rébiscoul et moi-même appelons immatériel114, c’est-à-dire les produits matériels auxquels sont incorporés des droits de propriété intellectuelle). Le patronat français a admis le rôle des services à l’industrie ou aux ménages directement commercialisables. Mais l’idée que les effets de réseaux, (externalités positives) jouent désormais un rôle crucial dans l’économie et que la captation de ces externalités soit à l’origine des plus fortes valorisations économiques, n’est pas encore considérée comme sérieuse. Elle est même jugée obscure dans le milieu de la publicité qui pourtant repose sur leur exploitation effrénée.
L’économie « matérielle » représente alors une base trop restreinte de la richesse. Du même coup, le dénominateur du ratio d’endettement devient faible par rapport au numérateur (les en-cours de crédit). L’effondrement actuel constituerait l’indispensable dégonflement de cette bulle artificielle, la purge nécessaire.
Nier que des bulles spéculatives soient encouragées délibérément par la cupidité des agents financiers, serait absurde. Cette composante intervient bel et bien ; mais elle ne suffit pas à expliquer leur explosion ni leur caractère récurrent. Les spéculateurs audacieux relaient les explorateurs et font des fortunes souvent éphémères. Les Madoff, les Kerviel, sont des produits naturels de l’intelligence humaine. Balzac a déjà tout dit d’eux.
En revanche, la puissance amplificatrice de la finance de marché est due à une transformation de la substance et de la forme de l’activité économique, de la richesse et de la valeur. La façon dont la finance de marché s’est installée progressivement en fournit quelques éléments.
Ne jetons pas la pierre à la finance privée. Ses instruments sont plus sophistiqués que ceux de la finance d’Etat, car l’exploitation globalisée requiert des échafaudages qui passent par les paradis fiscaux, les places off shore. Mais il en va de même, à l’échelle nationale, sous la houlette des Etats nationaux, pour la gestion de l’épargne par les banques. Les classes moyennes se sont détachées des classes populaires dès que les revenus du patrimoine ont complété le revenu salarial. Seules des réformes institutionnelles comme l’affectation de l’épargne des livrets A en France au financement du logement social, le statut des mutuelles, ont permis une redistribution plus égalitaire en direction des ménages incapables d’épargner et de constituer un patrimoine.
Ainsi, la marginalisation croissante de la gauche institutionnelle, hostile au capitalisme et le ralliement de la gauche blairiste au mécanisme de financement de l’économie de marché ne sont pas issus d’une incapacité de ces partis, ni de la trahison de leurs dirigeants ou de leurs penseurs attitrés, mais du fonctionnement financiarisé de la population, d’un biocapitalisme. Il suffit de penser à l’expansion vertigineuse des paiements par carte de crédit. On participe au système financier quand on utilise sa carte de crédit, quand on achète au supermarché et que le cash que l’on fournit à Carrefour ou à Walmart est placé par leurs services financiers dans les fonds de placement pour apporter des marges de 20 à 45 % à court terme, quand le fournisseur (le producteur) sera payé avec 45 à 90 jours de retard (35 jours théoriquement en France mais souvent le double de facto).
Il était impossible de réduire la dépense sociale : un transfert vers le privé ou vers les collectivités locales s’est souvent opéré, mais il n’y a pas eu de réduction de la part de la redistribution dans le PIB contrairement à ce qu’espéraient les fanatiques d’une baisse des prélèvements obligatoires. En outre, les programmes de réduction d’impôts diminuant les recettes publiques, les Etats centraux et les collectivités territoriales ont été conduits à s’endetter puis à refinancer leur dette en s’abonnant eux aussi aux produits financiers à haut rendement. Ce qui explique leur exposition aux produits toxiques qu’elles aient eu des excédents de trésorerie ou qu’elles soient endettées.
Lorsque ces moyens n’étaient pas suffisants pour tirer une croissance élevée qui seule rendait supportable la croissance criante des inégalités aux deux extrémités (non pas les déciles, mais les centiles) des revenus, la consommation des ménages a été favorisée par les bas coûts des biens fabriqués dans les pays émergents et particulièrement en Chine.
Mais, dira-t-on, ne suffit-il pas dès lors de revenir à une part plus élevée des salaires dans le revenu national pour rétablir un équilibre pouvant se passer de la rente de la finance de marché. C’est ici que se situe le véritable clivage dans la compréhension des transformations qui se sont produites dans la formation de la richesse et de la valeur économique.
Si l’on ne comprend pas la nature de cette dernière, on se fige sur un retour au statu quo ante lorsque le salaire affecté à chaque individu en fonction de sa productivité marginale constituait le principe théorique de la répartition. Dans une économie qui produit le vivant au moyen du vivant et gère la population, dans une société qui produit des connaissances nouvelles au moyen de connaissances, où la captation des externalités positives est la base du surplus capitaliste, il faut raisonner autrement, mettre en place de nouvelles catégories et repenser la richesse, la valeur, et réformer la répartition.
Pollinisation des abeilles et crédit
Dans une économie appréhendable comme un système complexe évolutif et non plus comme une structure donnée une fois pour toutes (paradigme mécanique)15 les interdépendances multidirectionnelles et la formation de nouvelles structures conduisent à privilégier le point de vue de la circulation de flux. Les ressources comme les surplus créés ne sont pas appréhendables comme le produit de nœuds ou de pôles d’abord isolés qui seraient réunis après coup par des échanges ou des relations isolables et finies. Cette correction d’optique ne revêtait guère d’importance dans un monde assez fruste s’occupant de produire des outputs à partir de ressources nommées inputs. Au contraire, ce schématisme était indispensable pour vaincre les résistances du vivant à se laisser enfermer dans ce procès de production. Il en va tout autrement lorsque l’activité humaine s’attache à explorer, exploiter la production du vivant au moyen du vivant ou à produire des connaissances qui permettent de faire ce qu’on ne savait pas encore faire.
Comme le souligne C. Marazzi16, la finance intervient d’ordinaire au terme du processus A-M-A’ (argent – marchandise obtenue par la production - argent incrémenté d’une survaleur). Le surplus ne surgit que de la réalisation de la marchandise sur le marché. Mais, la transformation majeure qui s’opère avec le biocapitalisme, régime dans lequel l’exploitation s’opère au niveau global de la vie des populations, réside dans ce que la finance intervient au début du cycle, donc on a A’-M-A’’, ce qui ne paraît pas constituer une révolution dans le capitalisme si le A’ initial provient bien du schéma précédent (les profits obtenus dans un cycle d’investissement-production-réalisation). Mais que dire si une forte composante de A’-A initial provient d’autre chose : par exemple du mode de production domestique ? C’était l’hypothèse de C. Meillassoux17 corroborée au sein de nos sociétés développées où les essais de mesure du travail domestique accompli par les femmes18 aboutirait à des rémunérations représentant deux fois le niveau du SMIC ! Que dire aussi si intervenaient des externalités positives résultant d’interactions positives non mesurées par l’économie d’échange marchand ? C’est au fond l’hypothèse que nous faisons dans le capitalisme cognitif : l’intelligence collective de la population devient un facteur de production direct qui explique le surplus de productivité globale des facteurs des comptables nationaux. C’est aussi ce que l’on retrouve dans ce que l’on appelle les externalités positives de réseaux19 qui ont révélé le phénomène et l’ont rendu tangible.
Or, réfléchissons à ce que nous avons décrit précédemment sur l’installation d’un régime de financiarisation : le revenu de la population ne dépend plus simplement du salaire, mais du rendement des placements de l’épargne à un niveau global, celui de la mondialisation des capitaux. Ce qui apparaît comme les rendements miraculeux du capital financier constitue la captation de tout ou partie des externalités positives.
Recourons à la métaphore de la pollinisation pour expliquer le changement de nature et d’échelle dans la richesse. L’économie politique classique ne s’intéresse dans le travail des abeilles qu’à la production d’output marchand (le miel) et ne prend pas en considération la production majeure du point de vue de la richesse pour l’humanité, la pollinisation vitale pour la biosphère. Les récents syndromes d’effondrement des essaims d’abeilles à partir de 2006 ainsi que l’introduction des abeilles africaines sur le continent américain, ou l’usage intensif des pesticides, ont permis d’évaluer en première approximation l’ordre de grandeur de la pollinisation par rapport à l’économie marchande. Le résultat est sans appel : la sphère de la pollinisation si on lui confère une valeur marchande (ce qui est un exercice futile en un sens puisque la pollinisation est sans prix, au sens où elle a un prix infini) représente entre 350 et 1000 fois la valeur économique de la production de miel.
Le multiplicateur de la finance de marché a reflété et traduit cette transformation de la richesse. Il est de 32 fois la sphère de la vieille économie matérielle, celle du circuit A-M-A’. Au regard des critères de l’économie industrielle, cela paraît résulter d’une pure spéculation improductive fruit de la cupidité. Mais, si nous rapportons le caractère débridé de la finance de marché par rapport à la finance publique, à la sphère de la pollinisation économique qui est le nouveau terrain d’accumulation du troisième capitalisme que nous appelons cognitif, d’autres biopolitique20, la démesure de la finance apparaît sous un jour plus intéressant que ces considérations moralisatrices21. Elle traduit l’irruption et le caractère désormais dominant d’un mode d’extraction de surplus capitaliste qui s’intéresse surtout à la sphère de la pollinisation. Cette mutation est un progrès par rapport à un capitalisme et à une théorie de la valeur exclusivement et aveuglément marchande dans son idéologie beaucoup plus que dans sa pratique. En effet, le dernier des agriculteurs se rend compte qu’il ne saurait indéfiniment se moquer des conditions générales de survie des abeilles. La prise en compte des conditions de préservation de l’environnement global de la vie humaine (la biosphère comme la noosphère) constitue dans le capitalisme cognitif l’équivalent de la découverte, sous le capitalisme industriel, que l’insatiable soif de travail (des femmes, des enfants, des ruraux) dans n’importe quelle condition et à n’importe quel prix que manifestait « l’homme aux écus » (Marx) finissait par menacer les conditions même de survie du capitalisme.
Le tableau suivant 8.1 suivant essaie de rendre compte de l’évolution du pouvoir de leviérage de la finance.

Tirons-en deux propositions pour la compréhension de la finance de marché (un régime de crédit globalisé). La première est que la finance de marché a été efficace pendant trente ans (efficace pour la formation d’un autre type d’accumulation, pas pour les abeilles humaines pollinisatrices) parce qu’elle s’est adossée, en la captant, à la sphère de la société pollen. C’est cet adossement qui a rendu crédible son multiplicateur de crédit qui, autrement, avait de quoi faire sauter au plafond n’importe quel banquier.
La seconde est que la crise qui s’est déclenchée plusieurs fois lors de l’explosion des bulles spéculatives pour devenir imparable avec la crise des subprimes, est une crise de la mesure. Une crise des conventions juridiques, politiques, sociales et économiques qui codifient ce qu’est la richesse et ce que la société décide de compter comme de la valeur (et pas simplement de la richesse). Quel est le déséquilibre croissant qui s’est instauré en quarante ans de globalisation financière ? En continuant à rapporter le rendement des capitaux pour tout crédit consenti, aux performances de l’économie industrielle encore ancrées dans le critère du matériel d’une part, de son caractère vendable sur un marché de l’autre, on a accentué la ruée sur la finance qui paraissait la seule productive. Pourquoi, se demandera-t-on, n’est-on pas allé fermement vers un changement de contrepartie du crédit (en particulier dans l’économie publique pour commencer, alors que celle-ci a fait le chemin inverse en subordonnant de plus en plus le « service public » d’éducation, de santé, de transport, de culture aux exigences de viabilité marchande) ? Pourquoi la puissance publique n’a-t-elle pas fait usage de l’emblème des abeilles (déjà choisi par Napoléon 1er) ? Pourquoi la finance mondialisée n’a-t-elle pas adopté une conception moins obsolète de la richesse alors que les contorsions comptables autour du phénomène du goodwill en donnaient des exemples boursiers quotidiennement ?
Parce que la découverte par le capitalisme cognitif de la sphère de la pollinisation et les immenses gisements de profit possibles des externalités positives comme terrain d’accumulation privilégié pose la question de la redistribution de cette richesse par un autre mécanisme régulateur que celui du salaire et du salaire social ou indirect. Le seul mécanisme qui ébauchait une redistribution aux salariés du surplus de productivité globale avait été amorcé sous le gouvernement Chaban-Delmas par la clause des contrats de progrès qui ajoutait à la partie fixe et à la partie mobile des salaires (primes individuelles), une troisième partie incluant une redistribution des gains de productivité globale. La montée des coûts salariaux, l’exacerbation de la concurrence internationale, la crise pétrolière et la montée du chômage ont limité ces dispositifs. Pire, la dégradation du salariat canonique dans les industries classiques, la montée du précariat (cognitariat, caritariat22) dans les secteurs les plus liés à la production immatérielle avec l’externalisation et la flexibilisation, ont amplifié le déséquilibre : l’appropriation du profit économique tiré de la sphère de la pollinisation est allée de plus en plus exclusivement aux détenteurs de parts (shareholders) de l’argent placé à l’échelle mondiale. La reconnaissance de l’activité humaine pollinisatrice en travail rémunéré et en emploi ramènerait la part des profits servis à des niveaux beaucoup moins mirobolants. L’endogénéisation des coûts pour l’environnement des activités industrielles ou des actes de consommation destructeurs ne s’est pas faite naturellement, il a fallu pour cela de fortes luttes des écologistes ou des catastrophes qui fassent changer d’un seul coup l’opinion publique. L’endogénéisation dans le calcul économique public et privé des externalités positives suppose que le travail gratuit qui les nourrit soit rémunéré directement ou que sa prise en compte donne droit à un revenu (et non plus à un salaire). A la différence du capitalisme industriel dont la rapacité n’excluait pas qu’il finisse par accepter le principe de rémunérer ses ouvriers, le capitalisme cognitif financiarisé a structurellement tendance, comme le capitalisme mercantiliste, à se comporter en prédateur par rapport aux externalités positives.
Ce faisant évidemment, il a accumulé les profits, réduit le nombre de salariés à temps complet dans le Nord, maintenu les 180 millions de Mingong23 sous le régime du Hukou (passeport intérieur) qui en fait des sans-papiers dans leur propre pays, et déséquilibré dans le revenu national le partage revenus/profit et pas simplement salaires/profit. Sans mesure correctrice puissante, comme un revenu d’existence généralisé, le capitalisme cognitif financiarisé est très instable24.
La crise à laquelle nous assistons correspond à la non rémunération de la pollinisation (externalités positives de la noosphère) et à la non prise en compte des externalités négatives qui menacent la pollinisation des abeilles au sens propre. En ce sens, elle dépasse en gravité la crise de 1929 car elle ajoute à la crise financière, une crise du capitalisme tout court face au défi écologique (régler le solde inévitable des externalités négatives) et à la nécessité de trouver un régime d’équilibre donc d’accepter un changement drastique dans la répartition des gains issus de la sphère de la pollinisation25. Dans tous les cas de figure, cela se traduira par une baisse considérable du rendement des capitaux et de l’épargne liquide. Or, le bloc des rentiers est beaucoup plus élargi, disséminé dans de larges catégories sociales pour être marginalisé par une politique keynésienne d’« euthanasie des rentiers ».
New Deal de l’économique et pas seulement de l’économie
Concluons. La crise de mesure du crédit et du multiplicateur de crédit dans la finance de marché tient à un changement de base réelle qui s’est déjà produit à son dénominateur. Le capitalisme cognitif ne peut plus reposer sur les conventions du fordisme, encore moins d’un néo fordisme qui s’appuierait sur le pouvoir centralisé du réseau des réseaux de façon autoritaire.
L’appel à l’économie réelle doit prendre en compte la pollinisation matérielle (écologie) et immatérielle (économie de l’esprit), sinon il aura beau répéter à la lettre les préconisations keynésiennes, il n’aura aucun effet positif. Un nouveau New Deal qui se contenterait de « relancer » la vieille économie matérielle conjuguerait le pire des complexes militaro-pétroliers, des corporatismes automobiles et des réflexes ultraconservateurs des rentiers et des retraités. Il faut un nouveau New Deal écologique de l’économique. Et en particulier une nouvelle donne comptable.
Quel keynésianisme de l’immatériel serons-nous capables d’inventer ? Comment mettre en place un changement de la convention d’emploi et de travail et une distribution entre les pollinisateurs et le capital de la rente de pollinisation. Il s’agit de tout autre chose que d’une répétition de la pièce des années 1930. Etant donné la façon dont elle s’est terminée avec la seconde guerre mondiale, nous n’avons aucune raison de fétichiser cette période.
Walter Christian & de Pracontal Michel (2009) Le virus B, crise financière et mathématiques, Editions du Seuil, Paris, 2009