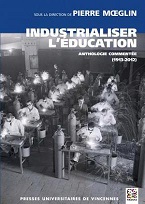Plan
Introduction : Présentation générale de l’ouvrage
« Industrialiser l’éducation » est une anthologie commentée dirigée par Pierre Moeglin et co-rédigée par 22 chercheurs ayant participé au Séminaire Industrialisation de la Formation1 (Sif). Cet ouvrage permet de découvrir une sélection de 21 auteurs ayant structuré le paradigme de l’industrialisation de l’éducation depuis le début du XXe siècle. Chaque auteur présenté est resitué dans son contexte permettant ainsi la mise en évidence des liens entre la recherche et la société, notamment les institutions internationales auxquelles de nombreux auteurs ont participé. Le choix de l’extrait est également expliqué et son contenu est complété et discuté ; tout cela dans des chapitres courts, regroupés en temps spécifiques, donnant ainsi une réelle dynamique à la lecture. L’objectif de suivre, non les situations de mise en œuvre, mais l’évolution de la référence industrielle, ainsi que la méthode de constitution du corpus, sont également précisés et argumentés dans l’introduction rédigée par Pierre Moeglin.
Pierre Moeglin est Professeur en sciences de l’Information et de la Communication (SIC) à l’université Paris XIII, « ses recherches portent en parallèle sur les industries éducatives et l’industrialisation de l’éducation, d’une part, et sur les industries culturelles et les industries créatives, d’autre part » (p.383) ; il est également co-rédacteur en chef de la revue Distances et médiations des Savoirs. En 1991, il a initié, avec Elisabeth Fichez, le Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) qu’il anime depuis cette date.
Cette anthologie permet de valoriser le travail collectif issu du Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) qui a regroupé de nombreux chercheurs autour de ce thème, permettant ainsi une approche interdisciplinaire du paradigme de l’industrialisation de l’éducation depuis ses origines (1913) jusqu’à son développement actuel (2012) :
Le séminaire sur l’industrialisation de la formation existe depuis 1991. Les chercheurs, membre de ce séminaire mènent une analyse collective sur ce thème en situant les interrogations à trois niveaux :
– la mise en question de la notion elle-même et son statut épistémologique,
– l’identification de ce qu’elle recouvre,
– la mise à l’épreuve de sa pertinence par une confrontation aux données empiriques.
La notion est abordée par différents biais mais toujours dans des perspectives partielles : celles des politiques et des logiques sociales, de l’économie des services et des industries culturelles, de l’expérimentation ou de la technologie éducative notamment. Ces points de vue sont croisés et leur mutuelle complémentarité est recherchée.2
Le titre de l’ouvrage « Industrialiser l’éducation » exprime la persistance historique du modèle industriel de l’éducation dont la forme évolue tout au long du processus d’industrialisation de l’éducation. Ainsi, ni pour ni contre, les auteurs de l’anthologie - qu’on appellera « commentateurs » pour les différencier des auteurs présentés dans l’anthologie – se placent plutôt en observateurs critiques du paradigme de l’industrialisation de l’éducation et de ses évolutions sur un siècle d’histoire.
L’ouvrage est structuré en cinq périodes, se chevauchant en partie, qui marquent les temps forts du paradigme du modèle industriel de l’éducation, son adaptation et son actualisation orientées par des objectifs et des contextes, des cadres théoriques et des apports scientifiques, liés à la société en évolution. Chaque partie ainsi que chaque chapitre est précédé d’un commentaire, rédigé par Pierre Moeglin, qui met en évidence la transition et d’un auteur à l’autre, d’une période à l’autre.
Le premier temps fort est celui des pionniers représentés par John Franklin Bobbitt, Joseph Wilbois, Burrhus F. Skinner et Lê Thành Khôi.
Les extraits de J.F. Bobbitt, tirés d’un ouvrage publié en 1913, son commentés par Pierre Moeglin avec la collaboration d’Alain Chaptal, ce dernier, ingénieur diplômé de Télécom ParisTech et docteur en SIC, « mène ses recherches sur l’analyse critique des approches française et anglo-saxonnes des technologies d’information et de communication pour l’enseignement et sur la question de l’efficacité de ces technologies » (p.381) ce qui explique sa position privilégiée pour collaborer au commentaire de l’extrait de J.-F Bobbitt.
Le chapitre consacré à J. Wilbois, présentant deux séries d’extraits tirés de son livre « La Nouvelle Education française » paru en 1922, sont commentés par Pierre Moeglin et Françoise Thibault, titulaire d’une thèse sur l’enseignement à distance et chercheure en SIC, ses travaux portent sur les « politiques publiques du numérique étendues aux grands secteurs d’intervention de l’Etat » (p.385) dont bien sur l’enseignement supérieur fait partie, ainsi que sur les « mutations des sciences humaines et sociales en lien avec la numérisation de la société » (p.385).
Les extraits de B.F. Skinner, tirés de son ouvrage le plus connu « The Technology of Teaching » paru en 1968, sont commentés par Pierre Moeglin, Jean-Marie Balle et Claude Debon, ces deux derniers travaillant tous deux sur la question posée dans le texte sélectionné quant à l’évolution du rôle de l’enseignant suite à l’intégration des « machines à enseigner » (p.106). En effet, Jean Marie Ball, spécialiste en informatique pédagogique, travaille entre autre sur « la question du rapport entre programmation et pédagogie » (p.379) et a publié un article portant sur l’évolution du rôle de l’enseignant-formateur ; Claude Debon, « psycho-sociologue de formation » (p.381), titulaire d’un DEA en Sciences de l’Education, est enseignante-chercheure à la Chaire de formation des adultes du Cnam, travaille sur « l’évolution des métiers de la formation confrontés à l’intégration des technologies de la formation et au développement des formations à distance » (p.381).
Le chapitre dédié à Lê Tành Khôi, présentant des extraits de son livre « L’industrie de l’enseignement » paru en 1967, est commenté par Pierre Moeglin et Judith Barna, titulaire d’un DEA en sciences du Langage et d’un doctorat en SIC, elle travaille sur « l’analyse des processus de modernisation dans l’enseignement des langues » (p.380) et s’intéresse en particulier au développement des dispositifs utilisant les technologies numériques dans la sphère éducative » (p.380), technologies sur lesquelles Lê Tành Khôi compte fortement pour permettre au modèle industriel de l’éducation de répondre aux besoins de la société.
Suite à ces premiers jalons du paradigme de l’industrialisation de l’éducation vient le « temps des critiques » illustré par Harold A. Innis et Jacques Piveteau.
L’extrait de H.A. Innis, tiré d’un texte intitulé « A Plea for Time » initialement prononcé en 1950 puis publié en 1951, est commenté par Gaëtan Tremblay, qui a également assuré sa traduction de l’anglais en français, et Didier Paquelin. Le premier est docteur en psychologie sociale, Professeur au département de communications de l’Université de Québec de Montréal (UQAM) et « poursuit des recherches sur les politiques publiques de communication, l’évolution socio-économique des industries de la culture et des communications, l’émergence de la société de l’information et la formation à distance » (p.386) ; le second est Professeur en SIC et expert auprès du ministère français sur les questions de pédagogie et numérique, il « contribue par ses recherches à une approche anthropologique de l’analyses des pratiques numériques par les enseignants et les apprenants » (p.384). Ensemble, ils mettent l’extrait de H. A. Innis en perspective avec les points de vue de M. McLuhan et G. Leonard.
L’extrait de J. Piveteau, tiré d’une publication intitulée « Ecole et industrie » parue en 1973, est commenté par Pierre Moeglin et Laurent Petit, Professeur en SIC dont les « travaux portent sur l’industrialisation de la formation, l’intermédiation en formation, les industries éducatives, leur lien avec les industries de la culture et de la communication et leur intégration éventuelle dans la catégorie nouvelle des industries créatives » (p.385). Là aussi, la pensée de l’auteur présenté est articulée à celle d’I. Illich avec lequel il était ami.
Vient ensuite « le temps des ingénieurs », regroupant six auteurs : Philip Hall Coombs, Guy Berger, Jacques Perriault, Geneviève Jacquinot, Gilbert Paquette et Monique Linard.
Les extraits de P.H. Coombs sont issus de son premier livre paru en 1968 « The World Educational Crisis : A Systems Analysis », mais c’est à la lumière du second paru en 1985 et intitulé « The World Educational Crisis : the view from the Eighties », qu’ils sont commentés par Pierre Landry - secrétaire général du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie et « expert dans le domaine de l’usage des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation depuis 1982, de l’autoformation depuis 1993 et des apprentissages tout au long de la vie depuis 2004 » - et Mohamed Sidir, Professeur en SIC qui s’intéresse à la « communication éducative médiatisée, plus particulièrement à ses développements dans le cadre des systèmes de formation entièrement ou partiellement à distance » (p.385) et qui travaille sur « les géométries institutionnelles et sur les stratégies d’acteurs face aux technologies numériques dans l’éducation » (p.385).
C’est au cours d’un colloque qui s’est tenu en 1982 que le texte sélectionné pour illustrer la pensée de G. Berger a été prononcé. Celui-ci est commenté par Pierre Moeglin et Eric Auziol, Maître de conférences en SIC issu des sciences de l’Education dont les recherches portent « sur les problématiques d’évaluation et sur les questions liées à l’appropriation des technologies numériques par les enseignants » (p.379).
Le chapitre consacré à J. Perriault, intitulé « industrie de la connaissance », présente des extraits de son livre « La Communication du savoir à distance » paru en 1996 qui sont commentés par Laurent Petit (également commentateur de J. Piveteau ci-dessus) avec la collaboration de Monique Commandré - Maître de conférences en SIC qui a travaillé sur l’enseignement à distance et dont les recherches « se situent à l’intersection de l’étude des technologies d’information et de communication et de celle de leurs usages » (p.381) - et de Roxana Ologeanu, Maître de conférences en SIC qui travaille « sur la question de l’appropriation des technologies dans les organisations, notamment dans le domaine de la santé » (p.384).
L’extrait de G. Jacquinot, issu de son intervention au colloque organisé par le Sif en mai 1992, est commenté par Pierre Moeglin et Elisabeth Fichez, Professeur émérite en SIC dont les « thématiques d’étude ont porté sur l’innovation pédagogique et les changements organisationnels, les pratiques collaboratives d’apprentissage avec l’Internet, la co-élaboration des dispositifs de formation et l’évolution corrélative de la notion d’usage » (p.382). La fin de sa carrière est marquée par une orientation de ses recherches sur « la numérisation de l’enseignement supérieur français » (p.382).
Les extraits de G. Paquette, issus de son livre « L’ingénierie pédagogique : pour construire l’apprentissage en réseau » paru en 2002, sont commentés par Monique Commandré avec la collaboration de Pierre Moeglin, Yolande Combès et Patrick Guillemet. Yolande Combès est Professeur émérite en SIC, ses « recherches portent sur l’industrialisation de l’éducation et sur les industries culturelles » (p.381) ; Patrick Guillemet, diplômé d’un doctorat en sociologie, s’intéresse aux interactions des étudiants à distance sur les réseaux sociaux » (p.382), « ses recherches portent sur le processus d’institutionnalisation des organisations dans le domaine de la formation à distance » (p.382), il est également « spécialiste des sciences de l’Education à la Télé-université de l’Université du Québec (Téluq) initiée par G. Paquette.
Les extraits de M. Linard, tirés d’une publication dans la revue « Education Permanente » parue en 2002, sont commentés par Claude Debon et Pierre Moeglin, avec la collaboration d’Elisabeth Fichez (également commentatrice du chapitre dédié à G. Jacquinot).
Après « le temps des ingénieurs », vient « le temps des analyses » représentés par Jean Gadrey, Jean-Louis Derouet et Luc Carton.
Les extraits de J. Gadrey, tirés d’une communication faite au « Colloque international sur la Notion de bien éducatif : services de formation et industries culturelles » organisé par le Sif en janvier 1994, sont commentés par Didier Paquelin (également commentateur des extraits d’H.A. Innis) et Jean-Luc Metzger, sociologue du travail dont les recherches portent sur « l’extension du fait gestionnaire à la plupart des domaines d’activité, tout en prenant en compte la financiarisation croissante des économies. En particulier, il analyse les transformations successives qu’ont connu les services publics (…) et les conséquences de ces changements permanents sur les pratiques et le pouvoir d’agir des professionnels » (p.382-383). Jean-Luc Metzger est ainsi particulièrement bien placé pour commenter la communication de J. Gadrey qui porte sur la rationalisation professionnelle.
L’extrait de J.-L. Derouet, issu d’un ouvrage collectif intitulé « Justice et justesse dans le travail » publié en 1989 dans les Cahiers du Centre d’Etudes pour l’Emploi, est commenté par Yolande Combès (également commentatrice des extraits de G. Paquette) et Nathalie Boucher-Petrovic, Maître de conférences en SIC, spécialiste de l’éducation populaire, « elle s’intéresse aux mutations liées aux médias numériques dans les champs de l’éducation, de la formation, du savoir et de la culture » (p.380), l’intermédiation dans l’éducation est un des axes structurant ses recherches.
Les extraits de L. Carton, tiré d’un article paru en 1993 dans la revue « Etudes de communication », sont commentés par Yolande Combès (également commentatrice de G. Paquette et J.-L. Derouet), Pierre Moeglin et Alain Payeur, ce dernier, décédé en 2012, exerçait comme Maître de conférences en SIC, « ses recherches ont notamment porté sur l’émergence de nouveaux territoires éducatifs, presse et salons étudiants, structures de vulgarisation scientifique » (p.384)
La dernière partie de l’anthologie, intitulée « Le temps des renouvellements » présente six auteurs : Otto Peters, Tony Bates, Christine Musselin, George Ritzer, Bjorn Stensaker et Tony Waters.
L’extrait d’O. Peters « provient d’un texte de 1997 disponible sur le site du Center für lebenslanges Lernen de l’Université d’Oldenburg » repris à quelques changements près dans un « chapitre d’ouvrage d’abord publié en 1998 sous le titre Didaktik des Fernstudiums, puis réédité en 2000 et 2001 et en 2004, en anglais sous le titre Learning & Teaching in Distance Education » (p.263). Ce chapitre est commenté par Judith Barna (également commentatrice du chapitre dédié à Lê Tành Khôi), Patrick Guillemet (également commentateur de G. Paquette) et Pierre Moeglin.
L’extrait de T. Bates, issu de l’ouvrage paru en 2000 intitulé Managing Technological Change. Strategies for College and University Leaders, est commenté par Jean-Luc Metzger (également commentateur des extraits de J. Gadrey), avec la collaboration de Pierre Moeglin et de Viviane Glikman qui a sélectionné et traduit l’extrait en question. Viviane Glikman, sociologue de formation et enseignant-chercheur en sciences de l’Education, ne fait pas partie des commentateurs de l’anthologie commentée, toutefois elle est membre du Sif depuis sa création en 1991, « ses travaux portent sur les usages et les usagers des médias et des technologies de l’information et de la communication dans la formation des adultes. Elle s’intéresse notamment aux représentations et aux pratiques des apprenants, aux « médiations humaines » et à la fonction tutorale dans les formations en ligne, ainsi qu’à l’histoire des formations à distance »3.
Le chapitre consacré à C. Musselin présente un extrait qui « provient d’une conférence qu’elle donne à Berkeley en février 2007 » (p.286) que Françoise Thibault (également commentatrice du chapitre dédié à J. Wilbois) a traduit en français et commenté.
Les extraits de G. Ritzer sont tirés d’une conférence qu’il prononce au cours du colloque scientifique « du Christ Chuch College de l’Université de Canterbury, en Angleterre, tenu en juillet 2001 » (p.297) et dont les Actes sont publiés en 2002. Le chapitre est commenté par Pierre Moeglin, Alain Payeur (également commentateur des extraits de L. Carton) et Marie-José Barbot, Professeur émérite en sciences de l’Education et sciences du Langage qui a beaucoup travaillé à l’étranger et dont les recherches « portent sur l’autonomie dans l’apprentissage, en formation et dans le champ de l’interculturel renouvelé, où la communication est centrale » (p.380).
L’extrait de B. Stensaker, issu d’un texte publié en 2007 dans le Journal of the Programm on Institutional Management in Higher Education de l’OCDE, est commenté par Pierre Moeglin et Bernard Miège, diplômé de deux doctorats d’Etat, en sciences économiques et Lettres et sciences humaines, Bernard Miège est, avec Pierre Moeglin dont il a encadré la thèse, un pilier de la théorie des industries culturelles et créatives ; « à l’initiative de Pierre Moeglin, il a été conduit à dresser un bilan des similarités et différences entre industries culturelles – dont il est l’un des fondateurs de la théorie et le pionnier en France - et les industries éducatives » (p.383).
Les extraits de T. Waters, tirés de son livre « Schooling Childhood, and Bureaucracy : Bureaucratizing the Child » publié en 2012, sont commentés par Pierre Moeglin, commentaire dans lequel apparait la question des raisons qui font que « l’industrialisme de l’éducation renaît régulièrement de ses cendres » (p.334) à laquelle Pierre Moeglin apporte des réponses dans la conclusion de l’ouvrage qu’il rédige.
Présenter les commentateurs, leurs disciplines scientifiques ainsi que leurs thématiques de recherche paraissait important dans le compte-rendu d’une anthologie dont les commentaires représentent quantitativement au moins la moitié de l’ouvrage et constituent un développement intellectuel important et à part entière qui consiste à mettre en évidence l’évolution historique et contextualisée du paradigme de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation. Cette démarche permet également aux auteurs d’interroger le concept même de l’industrialisation tel que défini par le Sif et d’en révéler toute la portée heuristique.
L’ouvrage étant structuré de façon éclairante, le présent compte-rendu tente dans un premier temps de restitué les idées principales constitutives de la trame de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation, ainsi il porte principalement sur les extraits des auteurs sélectionnés pour l’anthologie ; dans un second temps, les commentaires offrant une mise en débat des idées présentes dans les extraits, une proposition de mise en parallèle avec la pensée de G. Simondon est proposée, permettant, on l’espère, une poursuite de la réflexion des commentaires.
Trame de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation
Le temps des pionniers
Les extraits soigneusement sélectionnés de la première partie, intitulée « Le temps des pionniers », permettent de se faire une idée des origines du paradigme de l’industrialisation de l’éducation, d’abord avec J.-F. Bobbitt où l’objectif principal de rationalisation se heurte à la définition de l’efficacité imputable à l’institution scolaire, ensuite avec J. Wilbois dont le projet non concrétisé à l’époque, diversifie les conceptions possible d’une industrialisation de l’éducation en proposant une organisation corporatiste (néolibérale ?) encore susceptible de s’actualiser aujourd’hui. Puis, avec B.-F. Skinner et Lê Thành Khôi, viennent les technologies éducatives censées répondre à la fois à la demande croissante en éducation et à la tendance à l’individualisation des parcours en termes de contenus (B.F. Skinner), de rythme et d’encadrement (B.F. Skinner et Lê Thành Khôi), impliquant par là une transformation de la fonction d’enseignant dont le « vrai rôle » est censé se révéler. Décharger des besognes fastidieuses, le rôle de l’enseignant serait d’enseigner à plus d’élèves tout en individualisant les conditions d’apprentissage.
L’industrialisation de l’éducation doit permettre de répondre à la demande croissante de la société en éducation et aux besoins anticipés de main d’œuvre des entreprises, tout en favorisant l’épanouissement personnel (J. Wilbois), le développement des talents personnels (B.F. Skinner) et le progrès social (Lê Thành Khôi).
Pour cela, les découvertes scientifiques et techniques doivent être mises à profit au sein de l’éducation, que ce soit pour définir les « compétences » à acquérir (J.-F. Bobbitt), pour orienter les apprenants (J. Wilbois), pour individualiser l’apprentissage (B.F. Skinner, Lê Thành Khôi), ou contribuer au développement de la société (Lê Thành Khôi).
L’idée d’industrialiser l’éducation est toujours d’une part liée à la volonté « d’adapter un enseignement concret aux besoins de la société en général et de l’économie en particulier » (Bobbitt), et d’autre part associée au constat d’une inefficacité de l’enseignement tel qu’il est, que ce soit d’un point de vue quantitatif (nombre de diplômés) ou d’un point de vue qualitatif (choix des contenus et des méthodes pédagogiques). Les quatre auteurs ont ainsi en commun une vision adéquationniste de l’éducation par rapport au monde du travail et de la production.
Ainsi, la première étape du processus de technologisation commence dès le début du XXe siècle avec le Social Efficiency Movement porteur de la conception du système éducatif comme un système de production. Avec B.F. Skinner, « l’une des figures dominantes du behaviorisme, dit aussi « théorie comportementaliste » » (p.104), l’industrialisation de l’éducation trouve un premier cadre théorique qui porte principalement sur l’aspect pédagogique de l’enseignement et qui vise à concilier massification de la demande et individualisation des conditions d’apprentissage.
Le temps des critiques
Dans la deuxième partie, intitulée « Le temps des critiques », l’industrialisation de l’éducation fait ressortir les valeurs investies dans le système scolaire et dans ses différentes composantes, que ce soit l’université, qui se distingue de l’institut technique par sa mission de développer spécifiquement la pensée (H.A. Innis), où la structuration en différents lycées et collèges qui reflète la spécialisation de l’institution scolaire (J. Piveteau).
Ainsi, ces critiques mettent en évidence le rôle de la culture qui tend à devenir une « culture de la facilité » selon H.A. Innis, autoritaire selon J. Piveteau, et donc de l’idéologie qui se niche derrière l’idéal démocratique que vise l’égalité des chances par une homogénéisation du produit fini (J. Piveteau) qui se fait par le bas (H.A. Innis).
Le temps des ingénieurs
Dans la troisième partie, intitulée « Le temps des ingénieurs », le modèle industriel de l’éducation soutenu par l’investissement public, n’est plus un objectif mais un fait qui, en même temps, « entre en crise dès la fin des années 1970 » (p.153), et que l’ingénierie pédagogique doit permettre de poursuivre en favorisant la rationalisation des coûts (P.H. Coombs), l’articulation entre pédagogie et technologie (G. Berger), la mise au point d’un « sur mesure de masse » (J. Perriault), l’amélioration de la qualité de l’enseignement (G. Jacquinot), l’opérationnalisation des apports théoriques (G. Paquette) et l’instrumentation de l’autonomie de l’apprenant (M. Linard).
L’industrialisation de l’éducation s’appuie alors sur un deuxième cadre théorique qui ne porte plus seulement sur la pédagogie mais aussi sur l’aspect organisationnel de l’éducation : le systémisme (P.H. Coombs, G. Berger, G. Paquette).
Ce cadre théorique correspond aux constats de J. Perriault : d’une part « contrairement aux anticipations des années 1970, c’est la gestion de la formation et non la pédagogie qui a bénéficié le plus significativement des apports de l’informatique » (p.179) et d’autre part la « standardisation des modules de formation au service de la diversification des modalités pédagogiques repose sur la division du travail entre producteurs et distributeurs de connaissances » (p.181). Selon lui, il s’agit d’une « industrie de la connaissance » dans laquelle les expériences de la formation à distance ont permis de « mettre en avant la notion de logistique, jusque-là ignorée » (p.179).
De plus, ce cadre théorique constitué par la pensée systémique, « en mettant l’accent sur une autorégulation du projet et une harmonisation prétendument spontanée » (p.207), est porteuse d’une construction idéologique qui vise à naturaliser l’industrialisation en la présentant « comme un processus allant de soi, dont la dynamique serait auto-entretenue » (p.208).
Avec la décolonisation des années 1960, la question de l’éducation a en effet pris une dimension internationale illustrée par la conférence de l’OCDE à Washington en octobre 1961 organisée par P.H. Coombs selon qui « la crise mondiale de l’éducation », qui remonterait à une vingtaine d’années, amènerait « la nécessité de recourir (aussi) à d’autres modes de financement » (p.152) et surtout à la mise en avant de la recherche en ingénierie de l’éducation pour réduire le coût de la productivité de l’éducation (P.H. Coombs).
La problématique de l’industrialisation de l’éducation se complexifie, « l’enseignement est une « industrie à coût croissant » » (Lê Thành Khôi, P.H. Coombs) dont la caractéristique est d’être à la fois productrice et consommatrice de la main d’œuvre de haute qualité qu’elle forme et, par conséquent, en concurrence sur le marché du travail avec tous les autres secteurs recrutant de la main d’œuvre de haute qualité. Ainsi, se pose le problème de maintenir des salaires suffisamment attractifs pour les enseignants et la compétitivité de l’enseignement sur le marché du travail. Toutefois, la saturation du marché du travail change également la donne puisque « le système éducatif a moins besoin qu’auparavant d’efficacité industrielle, car il fournit désormais plus de « produits » que le marché de l’emploi n’en absorbe » ‘p.160).
Cette évolution du marché du travail explique pourquoi P.H. Coombs estime d’abord en 1968 que « L’Etat devrait redoubler d’efforts financiers, stimuler ses personnels et rendre plus attractif le métier » (p.159) avant de songer, en 1985, à la diversification des modes de financements, en provenance des entreprises et des fondations mais « aussi au financement en provenance des apprenants eux-mêmes » (p.161).
Toutefois, comme le rappelle G. Berger, si le processus d’industrialisation de l’éducation est déjà bien avancé aux Etats-Unis, où dès 1905, Theodore Roosevelt prononce un discours dans lequel il « félicite les enseignants d’avoir bien compris qu’ils étaient les premiers industriels de la société » (p.167), il n’en va pas de même en France où le système éducatif n’a pas eu « le même type de développement que le système éducatif américain » puisqu’il « ne s’est jamais perçu lui-même comme un système de production, mais comme un système culturel » (p.169).
Si aux Etats-Unis, la Technologie éducative doit augmenter la productivité des enseignants à moindre coûts, en France elle doit permettre de renouveler et d’améliorer les manières d’enseigner, « la Technologie y est sollicitée comme un analyseur critique, contribuant à déstabiliser les routines et idées reçues et à ouvrir l’école sur les réalités du mondes » (p.171).
Ainsi, G. Jacquinot se demande « pourquoi la tendance à l’industrialisation de la formation (…) s’accompagne-t-elle presque systématiquement d’une actualisation des modèles pédagogiques les plus dépassés ? » (p.190). En réponse à cette interrogation, G. Jacquinot dénonce, entre autre, l’approche technicienne qui véhicule « l’illusion de toute-puissance sécrétée par cette promesse illimitée et constamment renouvelable de la maîtrise par la technique (Sibony, 1989) » (p.191) ainsi que « la substitution progressive de la logique marchande au service public » (p.191) qui d’une part « change la nature du savoir », celui-ci devant se traduire en « quantité d’information », et d’autre-part exige des apprenants autonomes.
En effet, pour G. Jacquinot, l’autonomie de l’apprenant et sa participation à la production du service de l’enseignement est une condition indispensable à l’industrialisation éducative, c’est pourquoi « l’apprenant doit pouvoir trouver dans les dispositifs qui lui sont proposés le mode d’emploi de son apprentissage » (p.194).
D’une certaine manière, c’est ce que G. Paquette tente de réaliser dans les dispositifs d’ingénierie pédagogique qu’il conçoit « à l’intersection du design pédagogique, du génie logiciel et de l’ingénierie cognitive » (p.202). Selon lui, l’approche systémique est une méthode générale utile pour l’ingénierie pédagogique car elle invite à décomposer les problèmes complexes en problèmes plus simples et à « à distinguer l’élaboration du plan, ici la conception des matériels pédagogiques, de sa mise en œuvre » (p.202).
Selon G. Paquette, le processus d’industrialisation découle des « modes spontanés et autorégulés d’organisation » (p.198) et la fonction de l’ingénierie pédagogique réside dans « l’opérationnalisation des éléments théoriques et dans leur intégration en une méthode à la fois systémique et cognitiviste » (p.202-203). Pour lui, « la solution est un système à construire qui doit satisfaire certaines contraintes, très peu définies au départ, devant être spécifiées à la phase initiale, puis précisées tout le long du processus » (p.202).
Ainsi, selon G. Paquette, la fonction de l’ingénierie pédagogique présente « une double dimension systémique et industrielle » (p.203) et en même temps doit « donner aux apprenants les moyens d’organiser eux-mêmes leur trajectoire » (p.203).
Le terrain, avec le campus virtuel de la Télé-Université du Québec (Téluq), a cependant montré les limites de cette approche mise à mal par « l’organisation collective induite par le modèle systémique » (p.206). De plus, malgré cette volonté de spécifier les ressources au fur et à mesure du processus éducatif, « la modélisation des structures cognitives repose davantage sur les spécificités didactiques des contenus que sur les singularités de leurs modalités d’appropriation » (p.207). « Le substrat systémique de cette ingénierie pédagogique trahit-il donc, quoiqu’en dise G. Paquette, l’orientation fonctionnaliste et mécanique d’une approche sacrifiant la co-construction des connaissances par les apprenants à la planification programmée et industrielle du processus cognitif » (p.207).
C’est finalement ce que reproche M. Linard aux dispositifs techniques de formation qui tentent de tout contrôler alors que l’environnement d’apprentissage doit, selon elle, « fournir les repères cognitifs nécessaires pour juger, évaluer et corriger à mesure les résultats de ses actes : en référence aux savoirs établis, mais aussi dans l’interaction avec les partenaires (enseignants, pairs, institutions) qui, seuls, lui apportent le sens, les points de comparaison et les motifs qui l’aident à poursuivre son effort » (p.214).
En effet, si M. Linard estime que « l’apprenant est de loin son meilleur pilote » (p.214), les stratégies cognitives liées à l’apprentissage ne peuvent pas être entièrement rationalisées car elles ont aussi des dimensions « biologique, psycho-affective, socio-culturelle, éthique » (p.216).
Ainsi, « le dispositif technique n’est qu’un outil limité d’apprentissage parmi d’autres, à corriger et à compléter constamment par l’accompagnement humain et social qui fonde et organise toute construction individuelle de la connaissance » (p.214-215). Il ne s’agit donc pas d’idéaliser un apprenant autonome mais « d’instrumenter l’autonomie » au sein d’un environnement d’apprentissage hybride constitué à la fois de dispositifs techniques et d’opérateurs humains.
Le temps des analyses
Dans la quatrième partie intitulée « Le temps des analyses », la référence industrielle est d’abord remise en question au profit d’une rationalisation professionnelle dans l’enseignement supérieur (J. Gadrey), puis complétée par d’autres logiques coexistantes dans le domaine de l’éducation (J.-L. Derouet), et enfin élargie aux « métamorphoses de la démocratie » (p.254) au sein desquelles l’école « apparaît comme le point de convergence ou de passage du basculement du mode de développement, (…), et du compromis démocratique qui l’accompagne » (p.254) (L. Carton).
Pour J. Gadrey, l’industrialisation est une organisation mécaniste dans le sens où les modes de standardisation et de contrôle du travail sont majoritairement basés sur « l’usage convenable des machines et des équipements techniques » (p.228) et où les règles prescrites sont appliquées de façon mécanique par les opérateurs qui ont une faible marge de manœuvre et un « niveau minimal d’exercice du jugement et de la responsabilité de la décision » (p.229). De plus, un point essentiel réside dans le fait que « cela marche », c’est-à-dire qu’aux yeux des parties prenantes (clients, usagers, instituions bénéficiaires) les « traitements ainsi standardisés apportent des solutions satisfaisantes » (p.229).
On retrouve ici, le premier cadre théorique de la technologisation selon G. Berger : le behaviorisme reposant lui-même sur la définition de la vérité par l’utilité (pragmatisme), c’est-à-dire que « ce qui fait la vérité, ce n’est ni la fin ni le pourquoi, mais le fait que « cela marche » » (p.168).
Cependant, dans la perspective de J. Gadrey, les universités sont « aux antipodes du modèle mécaniste industriel » (p.229) du fait, entre autre, que « les méthodes des professionnels sont des méthodes intellectuelles (…) [qui] laissent à ceux qui les emploient une importante marge d’initiative » (p.229).
Selon J.-L. Derouet, le modèle industriel est bien présent dans les établissements mais ceux-ci sont des « entreprises composites » (p.239) où se côtoient plusieurs logiques en concurrence : les logiques « civique », « domestique », « industrielle » et « marchande ».
La logique civique repose sur l’intérêt général caractéristique d’un service public, tandis que la logique domestique « repose sur les idées de communauté scolaire et de continuité entre éducation dans la famille et éducation à l’école, l’accent y étant mis sur la formation du caractère (savoir-être) » (p.241).
Ainsi J.-L. Derouet observe que si la logique industrielle, qui « envisage sans frémir la disparition des espaces de sociabilités traditionnels » (p.242), s’articule avec la logique civique par laquelle elle se justifie « au nom de la démocratisation des études » (p.242), elle s’oppose à la logique domestique qui résiste au travers de la concentration des ressources techniques dans les établissements.
L. Carton s’inscrit dans la continuité de J.-L. Derouet en considérant la coexistence au sein de l’école des trois logiques, civique, domestique et industrielle. Mais pour L. Carton, ces trois logiques privilégient chacune « une figure différente, le futur citoyen, l’enfant ou le futur producteur » (p.253) et « servent des objectifs bien distincts » (p.253). Surtout, cette coexistence qui s’accompagne de « la perméabilité nouvelle des frontières entre Etat, marché et société civile » (p.254) « définit un moment historique que nous proposons de qualifier de « transition démocratique » » (p.254) dans lequel « l’école ré-émerge comme l’institution centrale » (p.254) et invite à « repenser l’association conflictuelle des trois systèmes d’acteurs (pouvoirs publics, ménages et entreprises) » (p.254).
Toutefois, les auteurs de l’anthologie notent que cette conflictualité culturelle se retrouve dans les représentations de l’industrialisation et les différentes formes que ce processus peut prendre. « De fait, il n’y a pas une industrialisation, mais des formes successives d’industrialisation, empilées et concurrentes » (p.256).
Le temps des renouvellements
Dans la cinquième et dernière partie intitulée « Le temps des renouvellements », la marge d’initiative laissée aux enseignants, qui expliquait le refus de J. Gadrey de considérer une industrialisation de l’enseignement supérieur, se combine avec une « une direction forte » (T. Bates) pour caractériser une nouvelle forme d’industrialisation néo- ou postindustrielle (O. Peters, T. Bates). La porosité des frontières entre Etat, marché et société civile, déjà notée par L. Carton, se développe avec l’intensification des échanges entre la sphère académique et le secteur privé (C. Musselin). Toutefois, à l’efficacité productive se substitue « l’efficacité de la consommation » (p.302) illustrée par la nécessité de « mettre en spectacle l’université » (p.302) pour contrer le processus de McDonaldisation identifié par G. Ritzer. Ainsi, selon B. Stensaker, les universités tentent de se redéfinir en développant des politiques d’image de marque qui « relèvent de la gestion du symbolique » (p.320), tandis qu’avec T. Waters, les réalités émotionnelles et affectives qui se jouent à l’école sont en contradiction avec les objectifs bureaucratiques, et mettent en question la pertinence des tests d’acquisition des compétences (caractéristiques de l’industrialisation de l’éducation aux Etats-Unis selon G. Berger (p.167)) lorsque ceux-ci deviennent le but de l’enseignement (p.167).
Pour O. Peters, l’enseignement à distance est « la forme d’enseignement et d’apprentissage la plus (intensivement) industrialisée ». Par conséquent, les organisations spécialisées dans ce domaine, telle que l’Open University, où le modèle d’industrialisation fordiste montre ses limites en termes de « rationalisation fondée sur la production de masse » (p.265) et d’organisation du travail, doivent être considérés, d’une part pour produire des marchandises en petites quantités et constamment adaptables aux multiples souhaits des consommateurs (néo-industrialisation), et d’autre part, dépassés pour limiter la division du travail au profit d’une structuration de petites équipes décentralisées, hautement qualifiées, autonomes et responsables de leur production (postindustrialisation (p.265-266)). Parallèlement, l’enseignement à distance, considéré comme une modalité pédagogique à part entière (p.261), devrait révolutionner l’enseignement traditionnel avec lequel il est appelé à se combiner (p.267) « dans le cadre d’un enseignement devenu hybride » (p.261).
Pour T. Bates, « les technologies de l’information ont suscité le développement de plusieurs industries de service, fondées sur la connaissance » (p.273) qui ont une structure postindustrielle caractérisée, entre autre, par « des produits et des services sur-mesure », « des employés décentralisés, responsabilisés et créatifs, travaillant souvent en équipe », et « un encadrement qui joue un rôle d’intégration, de coordination et de facilitation » (p.274). Ainsi, pour T. Bates, l’université se prête à l’organisation postindustrielle dans le sens où elle est décentralisée bien que hiérarchisée (p.274), et qu’elle constitue « par excellence une organisation fondée sur la connaissance au sens postindustriel, car elle crée et transforme la connaissance » (p.275). Malgré tout, l’université se différencie d’une organisation postfordiste par le fait que son cœur d’activité qu’est l’enseignement « n’est pas professionnalisé au sens où il serait fondé sur des compétences résultant de la recherche sur les processus d’enseignement et d’apprentissage et sur leur analyse » (p.275) alors « qu’une approche plus professionnelle de l’enseignement serait d’une importance cruciale pour des applications efficaces de la technologie à l’enseignement » (p.275). Les compétences à acquérir se trouvent ici du côté des enseignants qui doivent devenir des professionnels de l’enseignement pour intégrer efficacement les technologies de l’information (imposées (p.278) par la direction ?) sans perdre le sens de leur travail.
Pour C. Musselin, l’industrialisation de l’université est générée par la massification (p.287) des étudiants dans le domaine de l’enseignement mais aussi dans la recherche où les partenariats avec les entreprises favorisent la « diffusion des codes et de la culture du secteur industriel au secteur universitaire » (p.288). Elle observe donc un transfert des pratiques professionnelles du secteur privé vers la sphère académique, mais aussi une « transformation du travail dans le secteur non universitaire » (p.289), les deux tendances étant convergentes. Ce double mouvement amenant à des modes d’organisation en réseaux, caractéristiques de la structure postindustrielle où « l’autonomie, la responsabilité, la gestion du travail, la performance individuelle deviennent des qualités plus importantes que le niveau hiérarchique et le contrôle vertical s’en trouve affaibli » (p.290-291). Avec d’autres auteurs, c’est ce qu’elle nomme le « capitalisme académique » qui postule que les transformations de l’université sont moins dues à la présence des dispositifs techniques qu’à l’idéologie néolibérale et capitaliste (p.288). En effet, tandis que les objectifs des universités évoluent « à mesure qu’elles se transforment en « organisations productrices » » (p.291), les objectifs des entreprises restent inchangés, « il y a donc moins convergence entre entreprise et université qu’alignement tendanciel de la seconde sur la première » (p.291).
Selon G. Ritzer, le processus de McDonaldisation que connait l’université correspond à une forme d’industrialisation qui combine rationalisation de l’organisation (mesures quantitatives et planification dans un objectif d’efficacité), production d’un produit de « masse sur-mesure » standardisé et accessible (démocratisé pour le compromis avec la logique civique), et maximisation de la co-production du service par le consommateur (libre-service et servuction). Paradoxalement, cette McDonaldisation hyperrationalisée s’accompagnerait d’un « déclin de la qualité de l’éducation » (p.300) et d’un « désenchantement », en partie attribuable au remplacement (p.3004) des échanges interpersonnels avec les enseignants par des systèmes non humains (c’est-à-dire techniques), contre lesquels la mise en spectacle (p.300), grâce aux technologies, des activités universitaires quotidiennes (p.301) permettrait de lutter. Pour attirer et satisfaire les « consommateurs » (p.300) d’éducation, les universités devraient devenir des « temples de la consommation » (p.300) caractérisés par « ces nouveaux modes de consommation qui sont à la fois McDonaldisés et spectacularisés » (p.300). Cependant, selon G. Ritzer, « cela implique une inversion complète de l’une des caractéristiques fondamentales de la McDonaldisation » (p.301) : les systèmes non humains doivent être utilisés, non pour remplacer les systèmes humains, mais pour les améliorer. Il s’agirait donc, entre autre, d’hybrider les formations dispensées sur place (présentiel) ou à emporter (à distance) avec l’objectif de les rendre attractives car spectaculaires grâce à l’emploi de « solutions high-tech » (p.306) dans « un dispositif qui, dans l’amphithéâtre high-tech, permettrait à chaque étudiant de se servir de son ordinateur pour s’adresser au professeur » (p.306).
D’une certaine manière, les universités ont déjà commencé leur mise en spectacle, destinée à attirer leurs clients étudiants, en développant des stratégies d’image de marque (branding). Selon B. Stensaker, ces stratégies ont une fonction beaucoup plus importante que la seule « image attractive à l’ère de la marchandisation » (p.318). Elles constituent en effet « le moyen par lequel les universités s’efforcent de se réinventer en tant qu’organisations » (p.318) en repensant leur identité selon deux approches qui coexistent et se complètent : la première, qui résiste aux changements, correspond à stabiliser une identité dans le sens d’E. Durkheim ; la deuxième, « qui apparait au contraire comme l’un des ressorts de ces changements » (p.319) définit l’identité d’une organisation comme « ce qu’elle veut être afin de se distinguer de ses rivales » (p.319). Ainsi, selon B. Stensaker, élaborer une image de marque est à la fois un processus stratégique qui met « en relation intérêts extérieurs et objectifs internes » (p.318), et une « démarche progressive et continue qui peut permettre à l’université de conserver son statut d’institution sociale alors que l’enseignement supérieur devient un secteur marchand » (p.318).
Pour T. Waters, la bureaucratie éducative rationalisée qui doit permettre de « gérer des situations évolutives » (p.330) se heurte à la nécessaire « part d’interaction humaine et d’imprévisibilité » (p.329) liée à « l’environnement physiologique, psychologique et social de ceux dont cette bureaucratie s’occupe » (p.330). L’illusion bureaucratique, en recourant au behaviorisme aux dépends de la « pédagogie développementaliste – référence implicite à la psychologie génétique de J. Piaget- attentive aux progrès réalisés par le sujet dans l’acquisition de nouvelles aptitudes cognitives » (p.333) confond mesures quantitatives et réalités du terrain. La dérive qui découle de cette impossible conciliation entre le besoin de prévisibilité quantitative de la bureaucratie et la réalité émotionnelle de l’enseignement est illustrée par la loi américaine promulguée en 2002 « No Child Left Behind » (NCLB) qui amène une survalorisation des « niveaux atteints par les résultats aux tests » (p.331) conduisant à biaiser « le but de l’enseignement » (p.331). Pour reprendre les termes de J.-L. Derouet, la logique industrielle éclipse la logique domestique au point de faire perdre sa valeur à l’enseignement.
Les auteurs de l’anthologie, tenant pour acquis que du fait « des obstacles objectifs, liés aux contextes où elle intervient » (p.333), « l’industrialisation éducative se s’impose jamais spontanément » (p.333), posent alors la question fondamentale des raisons qui permettent à l’industrialisme éducatif de constamment se réactualiser.
A cette dernière question, l’anthologie apporte plusieurs réponses correspondant aux trois composantes du processus de l’industrialisation telle que défini par les auteurs de l’anthologie et du Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif), à savoir la conjonction de trois phénomènes : « La technologisation caractérisant la mise au point et l’utilisation de dispositifs numériques de scénarisation de la relation pédagogique ; celui de la rationalisation, montrant comment se met en place une organisation qui combine production de masse et production sur-mesure ; celui, enfin, de l’idéologisation, rendant compte de la profusion des discours » (p.295).
La conclusion intitulée « Pourquoi industrialiser ? » prolonge ainsi les principaux fondements du tropisme industriel, entre « virus quantophrénique » (p.336), autonomie de la technique illustrée par une bureaucratie qui « s’auto-engendrerait » (p.338), raisons idéologiques (principe de l’accountability (p.338), néolibéralisme (p.339)), contextes économiques ou encore politiques et géopolitiques. L’ensemble de ces observations reflétant des conceptions différentes de l’éducation qui coexistent ou se succèdent et qui font qu’il n’y a définitivement pas une mais des formes d’industrialisation dans le domaine de l’éducation.
(...)
Suite de la recension : www.reseau-terra.eu/article1395.html