La recherche que je mène s’inscrit sous l’égide de l’ingénierie des connaissances, en adoptant une double approche :
L’ingénierie des connaissances ne porte pas directement sur les connaissances, car ces dernières ne sont pas des objets matériels sur lesquels effectuer des manipulations et transformations. L’IC porte sur l’inscription matérielle des connaissances, en se fondant sur le fait que :
L’IC ne porte pas sur toutes les inscriptions de connaissances, mais celles qui adoptent le support numérique comme substrat d’inscription. Le numérique confère une cohérence et une unité à l’ingénierie des connaissances :
L’Ingénierie des connaissances sera donc l’ingénierie des inscriptions numériques de connaissances. Elle élabore des outils, méthodes et dispositifs mobilisant les inscriptions numériques pour assister le travail de la pensée et l’exercice de l’esprit.
D’un point de vue philosophique, l’ingénierie des connaissances repose sur l’articulation entre les supports d’inscription et les connaissances qui sont ainsi inscrites. La question est en effet de comprendre en quoi une inscription peut constituer et transmettre une connaissance. C’est donc une théorie de la connaissance qu’il faut élaborer : pour notre part, nous avons proposé la théorie du support.
D’un point de vue technique, l’ingénierie des connaissances comprend deux modalités essentielles :
Les inscriptions formelles correspondent aux représentations logiques formalisées modélisant le sens et la signification, que ce soit la signification de contenus, documents, pensées, expressions linguistiques, etc. Le principe est que la syntaxe formelle à la base de ces inscriptions contrôle et détermine la signification associée. Cette syntaxe possède donc une sémantique formelle.
Les inscriptions documentaires correspondent aux contenus mis en forme, produits, consultés et transmis à l’aide des documents. Les documents numériques reposent sur une numérisation du contenu où les unités numériques manipulées techniquement sont dans un rapport arbitraire avec les unités de sens interprétées par un lecteur. Par exemple :
L’intérêt des inscriptions formelles est de pouvoir déléguer à la machine des traitements reposant sur la sémantique des contenus manipulés ; l’inconvénient est de contraindre cette sémantique et de la réduire aux capacités expressives et calculatoires des formalismes.
L’intérêt des inscriptions documentaires est de pouvoir exprimer n’importe quel type de contenu et de signification associée, car la forme technique reflète l’apparence et non le sens du document. L’inconvénient est de ne pouvoir introduire simplement de l’« intelligence » dans les traitements effectués.
Du support numérique à la raison computationnelle prolégomènes et critique
L’ingénierie des connaissances comme projet implique une recherche croisant une réflexion sur la connaissance et une étude des artefacts permettant de l’inscrire et de la manipuler. Prise au sérieux, l’ingénierie des connaissances doit reposer sur une théorie de la connaissance d’une part et une ingénierie des représentations d’autre part.
Nous proposons une théorie de la connaissance, la théorie du support, selon laquelle toute connaissance procède d’une inscription matérielle dont elle est l’interprétation. L’idée principale est que la structure matérielle du support d’inscription conditionne l’interprétation de cette dernière et le contenu de la connaissance qu’on peut y reconnaître.
Puisque les supports d’inscription, ou //mediums//, sont des supports élaborés par la technique humaine, ils possèdent une histoire et leur évolution entraîne des révolutions dans les types de connaissances dont ces médiums sont à la fois l’inscription et la condition. C’est ce que les historiens nous ont appris à déceler dans le passage par exemple du //volumen// au //codex// ou encore lors de l’apparition de l’écriture ou de l’imprimerie.
Deux aspects privilégiés de la théorie du support nous intéressent particulièrement :
Support et connaissance
Selon notre hypothèse, le type matériel du support d’inscription et les propriétés de transformation et manipulation qui le caractérisent sont corrélés à un type particulier de rationalité et de manière de penser. A l’instar de la raison graphique proposée naguère par Jack Goody pour caractériser les conséquences cognitives de l’écriture, nous proposons la notion de raison computationnelle pour caractériser le mode de penser qui serait associé aux inscriptions numériques.
La raison computationnelle repose sur ce que le calcul apporte aux inscriptions et aux connaissances associées. De même que la raison graphique a permis l’émergence de structures conceptuelles et cognitives particulières comme la liste, le tableau, la formule ainsi que le schéma, on peut postuler que la raison computationnelle repose sur les structures de programme, réseau, couche et maquette numérique.
Mais la raison computationnelle reste une notion abstraite alors que notre expérience du calcul s’effectue à travers une ingénierie des systèmes informatiques qui implémentent ces calculs et des interfaces à travers lesquelles nous donnons un sens à ces calculs et aux entités manipulées. C’est pourquoi nous complétons la raison computationnelle par une phénoménologie du numérique qui porte sur l’expérience que nous avons du calcul. Cette phénoménologie nous intéresse particulièrement par les conséquences qu’entrainent deux aspects majeurs de la révolution numériques :
Nous nous intéressons donc particulièrement, à travers nos recherches sur l’indexation des grandes bases de données, notamment audiovisuelles, que ce que nous pouvons connaître de ces données et ce que nous pouvons connaître à travers ces données et documents.
Support et mémoire
Les supports d’inscription sont l’outil privilégié pour transmettre des contenus à travers le temps et permettre la gestion des connaissances dans la durée. Plusieurs phénomènes doivent être considérés :
Notre approche est de concilier ces deux aspects en articulant la tradition d’intelligibilité des contenus et la transmission des supports d’inscription. Nous avons donc élaboré une théorie de la mémoire et du rôle des supports pour mieux comprendre l’importance du numérique que nous mobilisons à titre expérimental dans la préservation culturelle numérique.
Responsable :
Participant :
Responsable de la formation doctorale pour Costech, avec Serge Bouchardon
Accès Web :
Parcours professionnel
Formation
Livres


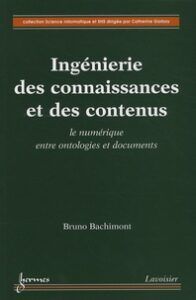

Revues
Conférences invitées :
Séminaires invités
